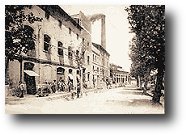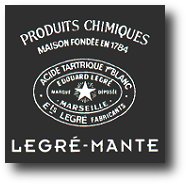| Compte-rendu rédigé par Alexandre Bourgne (2000) |
Avec sa capacité d’innovation, son implantation historique et ses liens avec l’environnement, la chimie entretient des relations étroites avec l’histoire sociale de la Provence. Des figures illustres apparaissent au détour des mutations profondes qu’a connues le secteur : Schloesing, Solvay, Balard, Chaptal… grands entrepreneurs, habiles stratèges, ils ont contribué à la réussite de sociétés aujourd’hui renommées. Les auteurs ont retracé cette fresque à travers des exposés riches et intéressants, et, habiles stratèges eux aussi, ont su parsemé leur propos d’anecdotes croustillantes : connaissez-vous l’origine du nom Pechiney ? La réponse vous surprendra peut-être… en fin de ce compte-rendu ! |
La chimie est une industrie séculaire en Provence. Il existe des savonneries à Marseille depuis le XIVe s., et le soufre est exploité dès le XVIIe s. Elle atteint son apogée au cours du XIXe. A la veille de la première guerre mondiale, cette industrie subit la concurrence d’entreprises étrangères, plus modernes, mieux structurées. Les principales filières sont sur le déclin. Pourtant, certains secteurs rebondissent. Cette période illustre comment les industries chimiques ont reçu de plein fouet puis intégré le modernisme et la réactivité anglo-américaine. Les grands marchés sur le déclin Au XIXe, l’industrie chimique phare de la Provence est le savon. On compte en 1911 pas moins de 40 entreprises, produisant 2000 tonnes, soit 50% de la production française. Ces entreprises ont une structure ancienne inadaptée à l’évolution du marché : trop nombreuses, divisées, elles manquent de fonds de roulement. Les huileries, principales clientes des savonneries, ont découvert de nouveaux débouchés : margarine, végétaline. Elles imposent leurs prix aux savonniers. Dans ce contexte difficile, ces derniers doivent aussi concurrencer l’anglais Lever, qui met en place un modèle d’entreprise intégrée, avec une forte concentration verticale, et une maîtrise interne des coûts. Lever possède des savonneries, des huileries, et dispose de ses propres voies maritimes. L’anglais s’installe à Marseille en 1913. Les savonneries ne peuvent résister. Cette industrie connaît une forte croissance au cours du XIXe s. Les entreprises marseillaises, leader mondial au début du siècle ont comme principal concurrent les américains, à travers les « Raffineries Internationales de Soufre » (RIS), qui représentent 20% du marché. Un nouveau procédé, le procédé FRASCH, vient révolutionner ce marché. Il permet de s’approvisionner en Louisiane. Les américains, comme dans la compétition entre Lever et les savonniers, ont une organisation moderne et verticale (liaisons maritimes) qui leur permet de s’imposer sur les entreprises marseillaises. Le rebond et les nouveaux débouchés En 1890, l’entreprise LEGRE-MANTE et Cie exploite le procédé Napoléon GLADYSZ pour produire de l’acide tartrique. En 1913, elle produit 1300 tonnes, soit 30% de la production mondiale, et est leader de ce marché. Malgré les faiblesses structurelles de la chimie provençale face aux concurrents étrangers, les entreprises ont fait preuve d’un sens de l’innovation pour se créer de nouveaux débouchés et couvrir de nouveaux marchés.
Les grandes évolutions de 1913 à aujourd’hui Le conflit mondial de 1914 amène l’Etat
à créer de nouvelles usines pour alimenter cette guerre.
Ainsi naissent les sites de St-Auban, construit en 4 mois par Pechiney
sur la Durance, des Lecques et de Port-de-Bouc. Cette période
voit la fermeture du site d’Alumine de St-Louis / Les Aygalades.
C’est Pechiney qui est à l’origine de leur chute
: profitant du climat anti-allemand il déclenche une cabale
contre son concurrent, en lançant : « Ils produisent
des obus allemands ! » (l’exploitant était une
société suisse). A l’issue de la seconde guerre mondiale, la
pétrochimie bénéficie largement du plan Marshall,
grâce à un important transfert de compétences
de la part des américains. Naphtachimie est créé
en 1947. Les maîtres mots sont dépression et
restructuration. Tableau actuel Le second est sans doute inhérent à
la chimie : c’est la rapidité des changements. On ne
connaît pas à un horizon de 3 ans les produits à
venir. Les entreprises chimiques de Provence sont tournées vers l’international :
En évoquant la Provence, on pense aux oliviers, aux champs de lavandes, au « puissant soleil de juillet [qui fait] grésiller les cigales », et à la mer turquoise qui vient faire la sieste dans la fraîcheur des calanques. C’est peut-être une représentation déformée : la Provence est aussi une grande terre d’industrie. Celle-ci a fortement impacté sur l’emploi, l’aménagement du territoire, le commerce. L’industrie chimique n’est d’ailleurs pas la seule présente en Provence : la métallurgie, l’agroalimentaire et le charbon ne doivent pas être oubliés. Sujet longtemps tabou, les relations entre la chimie et l’environnement sont aujourd’hui au cœur des campagnes de communication des entreprises. Elles rivalisent d’initiatives pour le progrès et les réglementations anti-pollution. La chimie assoit son avenir dans le développement durable. Chose promise, chose due : l’ingénieur de la Compagnie Générale de la Chimie André VANGOD avait un surnom tiré du provençal : « Pitchounet ». Ainsi naquit Pechiney. |
Toute l'assemblée a été évidemment séduite par nos deux historiens, que ce soit la rigueur et la précision historique de Xavier Daumalin, ou l'enthousiasme de Philippe Mioche pour son sujet. Ce soir, les "ingénieurs" ont pu se rendre compte de l'apport des "universitaires" dans leur métier : ouverture, recul, réflexion. A l'heure où les échanges sont de plus en plus virtuels, nous avons également pu prendre conscience de notre "devoir de mémoire" vis-à-vis des historiens de demain. Ce compte-rendu serait incomplet si deux auditeurs plus particulièrement attentifs n'étaient pas cités ! Tout d'abord notre camarade André Espagnach (69), délégué général de l'UIC PACA et Corse ; et bien sûr Robert Legré (43), descendant de la famille du même nom, fabricants d'acide tartrique "Maison fondée en 1784" !
|
Les conférenciers |
| Philippe
Mioche est professeur d'Histoire contemporaine à
l'Université de Provence, Directeur de la Maîtrise
de sciences et techniques Etudes Européennes, Chaire
Jean Monnet d'Histoire de l'intégration européenne.
Il est notamment l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Europe, et sur l'histoire économique et industrielle, dont celle de la Provence :
Entre autres publications, il a participé à la rédaction de plusieurs tomes de l'"Histoire du commerce et de l'industrie de Marseille", et est co-auteur d’un ouvrage sur "La réparation navale à Marseille" (Ed. Jeanne-Laffitte). Son prochain ouvrage "Du sel au pétrole : l’industrie chimique de Marseille-Berre au XIXe siècle" paraîtra en avril aux éditions Tacussel. Philippe Mioche et Xavier Daumalin sont fondateurs de l'association "Mémoire, Industrie, Patrimoine en Provence".MIP Provence édite notamment la revue semestrielle "Industries en Provence" disponible sur abonnement.
|
Liens |
| Quelques liens autour de cette manifestation :
|
|
|
Les illustrations viennent des sites cités.
Charte Internet, vie privée
![[Retour page d'accueil]](images/sk_default_headlogo.png)

 Cette
étude « Provence, terre de chimie
» a été réalisée à l’occasion
du centenaire de l’Union des Industries Chimiques
de Provence par 2 historiens de l’Université
d’Aix-Marseille : MM.
Cette
étude « Provence, terre de chimie
» a été réalisée à l’occasion
du centenaire de l’Union des Industries Chimiques
de Provence par 2 historiens de l’Université
d’Aix-Marseille : MM. 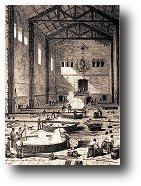
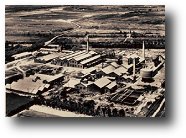 En
1911, on compte 20 soudières en Provence : Marseille, Septêmes,
Istres, et même Porquerolles ! A tel point qu’on parle
du « littoral de la Soude ». Toutes ces soudières
utilisent le même procédé : le procédé
Leblanc. Or ce marché est bouleversé par le nouveau
procédé Solvay, moins cher et moins polluant. Pour
résister, les entreprises tentent de développer la
filière de la soude à l’ammoniac, notamment
à Salins et dans le Vaucluse. Mais Solvay implante une usine
à Marseille et en 1902 les marseillais renoncent à
produire de la soude. Mais d’autres horizons se profilent
pour les soudières…
En
1911, on compte 20 soudières en Provence : Marseille, Septêmes,
Istres, et même Porquerolles ! A tel point qu’on parle
du « littoral de la Soude ». Toutes ces soudières
utilisent le même procédé : le procédé
Leblanc. Or ce marché est bouleversé par le nouveau
procédé Solvay, moins cher et moins polluant. Pour
résister, les entreprises tentent de développer la
filière de la soude à l’ammoniac, notamment
à Salins et dans le Vaucluse. Mais Solvay implante une usine
à Marseille et en 1902 les marseillais renoncent à
produire de la soude. Mais d’autres horizons se profilent
pour les soudières…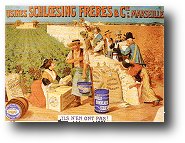 Ne
pouvant rivaliser avec leurs concurrents, les soudières Leblanc
changent de stratégie et se reconvertissent dans la production
du Chlore (HCl) et de l’acide sulfurique (H2SO4), avec comme
débouché les marchés du sel et des engrais
chimiques.
Ne
pouvant rivaliser avec leurs concurrents, les soudières Leblanc
changent de stratégie et se reconvertissent dans la production
du Chlore (HCl) et de l’acide sulfurique (H2SO4), avec comme
débouché les marchés du sel et des engrais
chimiques.